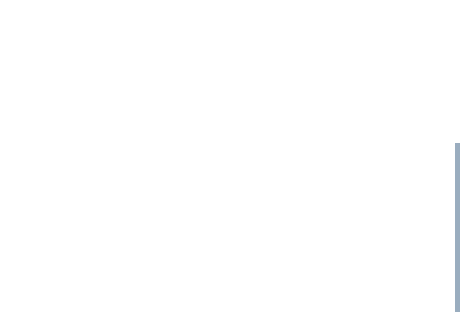|
|
La meule
Moudre du blé constitue tout un art. On pourrait croire qu'il suffit d'écraser le grain entre deux pierres pour en extraire de la farine, alors que cette opération nécessite une grande habileté de la part du meunier.
Les meules de son moulin doivent tourner à une vitesse et à un écartement bien précis, être souvent repiquées au marteau pour garder leur abrasivité.
Les 2 faces des meules ne sont pas parfaitement planes :
D'une part, elles laissent un petit espace entre elles dans la partie proche du centre, pour que les grains puissent pénétrer entre les deux roues.
D'autre part, elles portent sur les surfaces se faisant face des rainures, de moins en moins larges et de moins en moins profondes lorsque l'on se rapproche de la périphérie.
Ces rainures favorisent le déplacement des grains vers l'extérieur, ce qui permet d’arracher d’abord leur enveloppe puis de les écraser.
Surtout, elles ne doivent pas être taillées dans n'importe quelle pierre. Une roche trop souple ne ferait que déchiqueter le blé et donnerait un gruau dont on ne pourrait retirer le son; à l'inverse, une pierre trop dure transformerait la farine en une poussière difficilement panifiable, chargée en plus d'une huile empêchant sa conservation.
Enfin, les meules ne doivent pas s’user trop rapidement sous peine de ruiner leur propriétaire, puisqu'une seule de ces pierres équivaut au prix d'une maison au XVIIIe siècle. La pierre idéale doit donc posséder plusieurs qualités contradictoires, être à la fois solide, dure et souple. Une meule a une durée de vie moyenne d'une quarantaine d'années et doit être "rhabillée" (piquée, mieux rainurée) tous les 2 ou 3 mois, si l'on désire un bon rendement.
Au Moyen Age, les meules ne sont pas rainurées, elles ne sont que "piquées". Au XIXè siècle, les meules deviennent plus efficaces, ce qui permet de réduire les "issues" (ce qui n’est pas conservé) et donc d'augmenter la proportion de farine utilisable pour l'alimentation humaine.